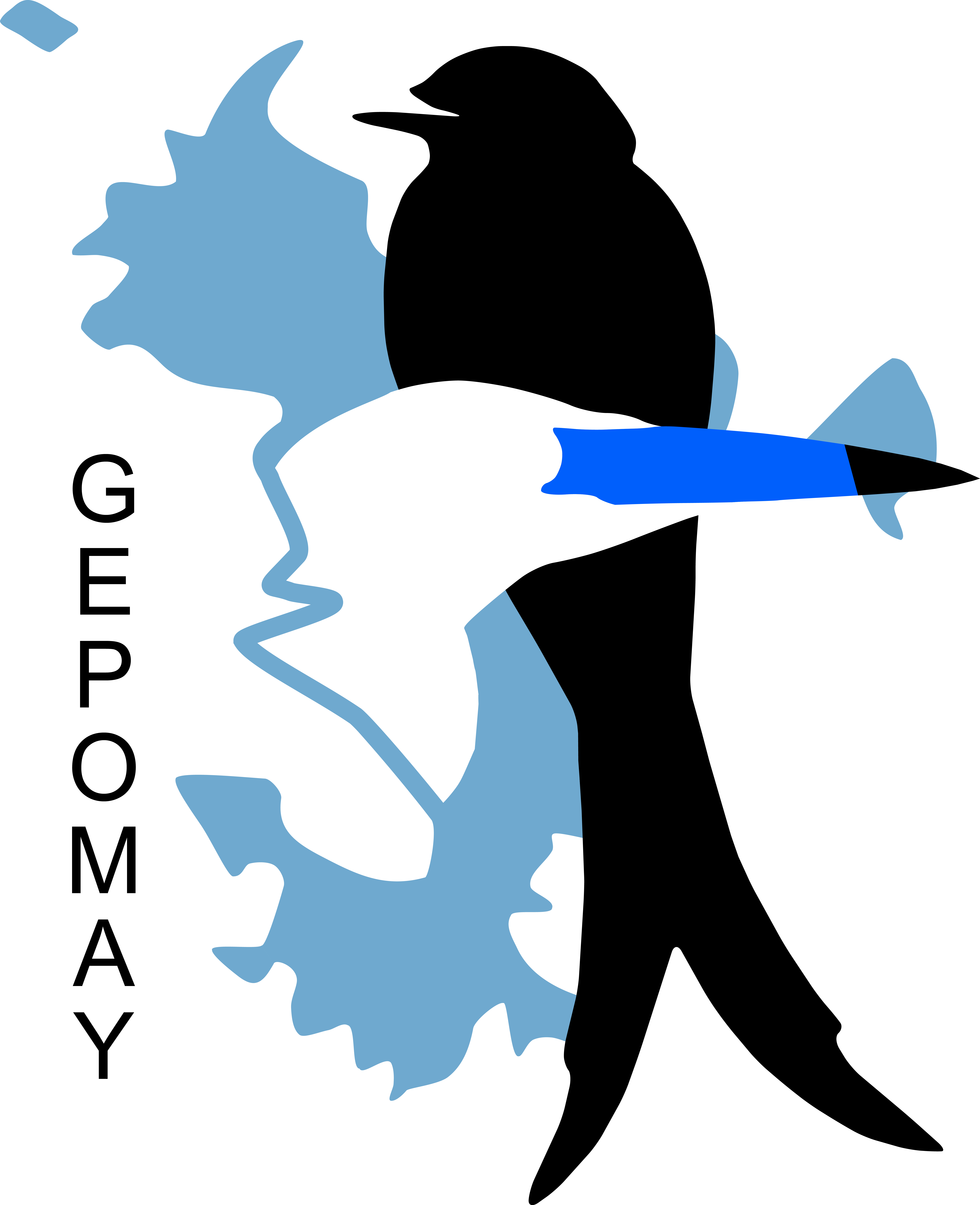16 juillet – Journée mondiale des serpents
Serpent des cocotiers – Crédit : Louis Rubini Les serpents de Mayotte : espèces méconnues, inoffensives et essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes La Journée mondiale des serpents, célébrée chaque année le 16 juillet, a pour objectif de sensibiliser le public à l’importance écologique des serpents, à leur rôle fonctionnel dans les écosystèmes, ainsi qu’aux …
Lire la suite de« 16 juillet – Journée mondiale des serpents »